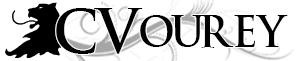Une Histoire

Les croix de Vourey
Les croix permettaient autrefois de marquer les limites des terres, les croisées des chemins, et indiquaient aussi le parcours des processions religieuses ou commémoraient des missions.
Le carrefour est un lieu de rassemblement, et aussi un lieu de délimitation à la campagne, de parcelles, de fiefs, de terrains communaux. Les carrefours portent souvent des noms par lesquels les habitants des alentours peuvent se repérer.
Le carrefour, dans de nombreuses symboliques, évoque un choix pour lequel il est facile de se tromper de direction, donc de tomber sous la domination des puissances maléfiques.
Comme symbole de délimitation de propriétés, on lui associe naturellement un besoin de protection. C'est aux carrefours que l'on donne ainsi un sacrifice aux Dieux, souvent des offrandes d'aliments. C'est aux carrefours que les processions, dont le but est l'invocation de protection divines ou de saints, font naturellement des haltes.
Notre village a gardé dans sa toponymie le souvenir de croix aujourd’hui disparues et il comporte des croix, plus ou moins bien conservées.
Sur la commune de Vourey nous pouvons encore en dénombrer huit.
A titre de souvenir, il faut citer la croix Pagnon (lieu situé au bout du Bayard, du côté de Moirans) qui identifiait la famille Pagnon ou Panion,
propriétaire de cette croix ou du terrain sur laquelle elle se trouvait, ou la croix Mosnier (Monnier, Mounier) patronyme d’une famille souche du village de Vourey.
Au cœur du cimetière, une croix se distingue au milieu du carré des tombes des prêtres.
Elle porte l’inscription « Mission 1887 » avec l’ajout d’inscriptions à caractère funéraire. Il s’agit d’une croix de mission, sans doute installée à l’origine ailleurs dans la paroisse,
et reconvertie en croix de cimetière.
La plus belle croix encore existante est celle placée à l’intersection entre la route de l’église, la route de la Fontaine Ronde et la route du Sabot.
Selon les services du patrimoine du département, cette croix plate en fer forgé est fixée sur un haut socle en pierre, aux angles arrondis. Ses montants
et traverses sont ajourés de très petits motifs géométriques formant une dentelle centrale, tandis que des éléments trilobés à petites pointes en garnissent les extrémités.
Quatre petits éléments en forme de gâble (ornement décoratif de forme triangulaire) sont disposés en gloire, autour de la croisée. L’élément le plus remarquable est form é par une figure découpée dans le bas du montant de la croix, qui semble représenter en découpe plate, avec très peu de relief, une vierge à l’enfant assise.
Il convient encore de mentionner les hautes croix métalliques du Point du Jour et des rivoires figurant sur les cartes d’état-major de la fin du XIXe siècle.
Et enfin, parmi les croix récemment disparues, la croix de Chougnes, dans le chemin du Viéron, dont il ne reste plus que le socle, et la croix métallique de l’église érigée encore récemment devant la placette précédent l’entrée de l’église. Elle était fixée sur un angle du haut mur de clôture délimitant le jardin de l’ancienne cure.
Espérons que cette croix retrouve un bel emplacement suite aux travaux du parvis de l’église à venir.
La fin du XIXe siècle et le début du XXe furent marqués par de violentes querelles politico-religieuses qui aboutirent à la fameuse loi de 1905 de séparation de l’église et de l’état.
A Vourey, comme ailleurs, deux blocs s’affrontaient : les partisans de l’église et les anticléricaux.
Témoin de cet extrait du journal anticlérical « La Calotte » du 28 avril 1901 :
A propos de croix…
A Vourey le conseil municipal, en majorité réactionnaire, avait voté quarante francs pour élever une croix sur le Grand Chemin.
A la suite d’une pétition de quarante électeurs de la localité adressée à la préfecture et protestant contre un pareil emploi des fonds des contribuables, la délibération du conseil municipal fut purement et simplement annulée.
Pour écouter la page en version audio veuillez cliquer ci-dessous
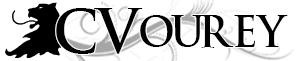
GALERIE PHOTOS





1 ‐ Sortes de crécelles, composée de deux languettes de bois, que le lépreux frappait violemment l’une contre l’autre pour attirer les passants et solliciter leurs aumônes.
L’homme qui descendait lentement le chemin du petit bon dieu en cette fin d’automne 1488, était vêtu d’une simple robe de bure et de sandales de cuir usé.
Ses mains, anormalement épaisses, étaient cachées sous des gants, qui jadis devaient être blancs.
La pluie ruisselait sur son visage boursouflé ou l’on pouvait encore distinguer le gris acier de ses yeux. Il avait de la peine à respirer, mais il savait que son seul salut était peut être au bout de ce chemin boueux, qui descendait vers le ruisseau Dolon.
Il savait également qu’il aurait dû signaler sa présence tout au long de son parcours, le long des rues et chemins du bourg, en agitant la cloche ou les cliquettes1 fixées à sa ceinture de lin, mais il n’en avait plus la force.
Quiconque le croiserait en cette nuit blafarde de fin novembre ne pourrait reconnaitre, derrière ce visage déformé, l’un des commerçants les plus prospères de la bonne ville de Grenoble, qu’il était quelques années plus tôt.
A cette époque, le commerce de lingerie fine, qu’il tenait place aux herbes était connu et fréquenté par la plus haute société de cette cité du Dauphiné.
Les tissus des Indes les plus délicats et les plus riches se trouvaient alors en son échoppe.
Il était respecté, argenté, et côtoyait les plus nobles.
Antoine Tête, que l’on appelait autrefois, Maistre Tête, constituait le fleuron et la fierté de l’ancienne cité des Allobroges.
Ce n’était plus aujourd’hui qu’un être aux traits informes, affligé de la pire plaie du Moyen-âge : la lèpre.
Il avait vu son épouse, Adémar, périr en juin 1486 de cette maladie. Il l’avait veillée jour et nuit sur son lit de douleur, jusqu’à son dernier souffle.
Depuis, il avait vu apparaître les mêmes signes insidieux, qui envahissaient son corps jour après jour. Certes, dès les premiers symptômes il avait réussi à cacher les stigmates de cette "honteuse" maladie par des onguents et crèmes achetés à prix d’or, mais inexorablement, le mal continuait à ronger ses chairs.
Tous ses clients, amis, et connaissances se mirent à le fuir.
Tous le repoussaient avec dégoût.
Il était devenu le paria, l’exclu, au sein même de la cité qui l’avait encensé et lui avait offert richesse et gloire.
Malgré sa peau meurtrie, son esprit fonctionnait encore fort bien et sa mémoire demeurait intacte.
Tout en marchant, les souvenirs surgissaient.
De bien tristes souvenirs…
La mise en terre de sa chère épouse tout d’abord.
Le rang et la fortune de Maistre Tête lui avait permis de la soigner, cachée en sa demeure, alors que ses frères d’infortune étaient chassés de la ville.
A son décès, il avait réussi, en faisant jouer ses innombrables relations, à lui offrir son dernier sommeil au sein de l’église Saint-André proche de chez eux, au pied de l’autel où elle avait tant prié.
Très rapidement après le départ de sa tendre épouse, la maladie, inexorablement, fit en ses propres chairs son cruel office, et bientôt il ne put plus cacher les stigmates qui déformaient son corps.
Dénoncé par ses anciens amis, et bien que restant reclus dans son hôtel particulier, il fut mandé au tribunal de Grenoble et soumis, par l’ordre d’un magistrat, à l’examen d’un médecin assermenté.
Il fut reconnu "ladre" et on le condamna à être exclu de la maison qu’il habitait et relégué dans une léproserie. Cette sentence fut lue solennellement au prône de l’église Saint‐André et exécutée le dimanche suivant, selon le cérémonial fixé par l’Eglise de Vienne.
Ainsi, ce jour-là, Maistre Tête fut conduit en procession par le clergé, de sa maison jusqu’à l’église Saint-André, où il lui fut permis d’entrer une dernière fois.
Assis tout seul au milieu de la nef vide, il entendit la messe. Une fois l’office terminé le prêtre s’approcha de lui et, pour le réconforter, lui adressa une brève allocution :
"Mon ami, il plaist à nostre Seigneur que tu soyes infect de ceste maladie et te fait Nostre Seigneur une Grant grace quant il te veut punir des maux que tu as fait en ce monde. Pourquoy, aies patience en ta maladie ; car Nostre Seigneur, pour ta maladie ne te desprise point, ne te separe pas de sa compagnie ; mais si tu as patience, tu seras sauvé comme fut le ladre qui mourut devant l’ostel du mauvais riche et fut porté tout droit en paradis".
Puis le prêtre bénit le vêtement qui lui était destiné en tant que lépreux et dont la forme et la couleur spéciales devaient le désigner dorénavant à l’attention publique.
Le prêtre revêtit le malheureux Antoine Tête en prononçant les paroles suivantes : "Vois‐tu icy la robe que l’Église te baille en toy deffendant que jamais tu ne portes robe d’autre façon, afin que chacun puisse recoignoistre que tu es infect de ceste, et que l’on te donne plus tost l’Aumosne pour l’amour de Nostre Seigneur".
Le prêtre bénit ensuite les gants et les remit au malheureux en disant : "Vois-tu icy des gants que l’Église te baille, en toy deffendant que, quant tu iras par les voyes, tu ne touches à main nue auculne chose".
Enfin, il bénit les cliquettes que l'Eglise ap-pelait les langues de bois du ladre.
En les lui donnant, le prêtre dit : "Vois‐tu icy la langue que l'Église te baille, en toy deffendant que tu demandes jamais l’aulmosne sinon à cet instrument et aussy te défend l’Église que jamais tu ne parles à personne si l’on te fait parler".
Après ces pieuses exhortations, Antoine Tête fut conduit par le prêtre hors de l’église Saint-André, jusqu’au parvis, pré-‐ cédé de la croix.
En traversant la foule qui se trouvait sur la place jouxtant l’église Saint-André, il aperçut son plus jeune apprenti, Jean Chanin, qui le suivait du regard en pleurant.
Ce dernier s’approcha de lui et lui déclara d'une voix étouffée par l'émotion : "Mon bon Maistre, par pitié et au nom de Nostre Seigneur, allez à la maladrerie Marie-Magdeleine de Dolon car son eau fait des miracles."
Antoine Tête lui adressa un sourire résigné et continua à traverser la place d’un pas lent.
Il savait que son long chemin de souffrance ne faisait que débuter !
En Dauphiné, les maladreries ou léproseries, jalonnaient en effet les grandes routes de deux lieues en deux lieues.
Sur son chemin d’infortune, Antoine Tête en avait croisé un bon nombre.
Mais les dernières paroles de son jeune apprenti résonnaient encore dans sa mémoire. Son seul salut était sans doute le ruisseau Dolon et sa maladrerie.
Ce ruisseau Dolon, il le savait, prenait sa source dans le village de Saint-Cassien où il portait alors le nom de Capadière.
Ensuite, ce petit ruisseau au caractère fort changeant, séparait les villages de Moirans et de Charnècles.
Empruntant le vallon très encaissé du "Bois du Ri", il laissait seulement la place à un chemin de chars lequel conduisait de Manguely au hameau du "Sabot" du bourg de Vourey.
Enfin, après la traversée de Vourey, il se jetait dans la Fure, non loin du confluent de cette rivière avec l’Isère.
Il avait également entendu parler de cette fameuse chapelle de la léproserie Marie- Magdeleine de Dolon et de sa "Fontaine aux lépreux".
Les eaux de ce ruisseau, par la sainteté du lieu, faisaient, paraît-il, des merveilles et l’on parlait de guérisons…
Depuis quelques années, les lépreux qui avaient la chance de découvrir cette maladrerie, allaient se tremper dans les eaux du ruisseau Dolon.
Un de ses anciens amis lui en avait même précisé le lieu : l’endroit où le lit du Ri était le plus encaissé, à l’entrée du bois de Manguely.
En principe, les lépreux ne devaient pas quitter leur retraite dans laquelle était pratiquée une loge d'où ils pouvaient, à l’aide des cliquettes, implorer la charité des passants. Mais cette règle était dérogée en l’hôpital de Dolon.
De larges adoucissements, en effet, permettaient aux malades de se baigner dans l’eau bienfaisante du ruisseau Dolon.
Toujours d’après son ami, l’hôpital de Dolon, car tel était son nom, avait semble-t‐il été fondé du temps des premières Croisades par le Comte de Savoie, et confié pour un temps aux Hospitaliers.
La maladrerie de Dolon et la chapelle connue sous le vocable Sainte Marie-Magdeleine (la sœur de Lazare que Jésus ressuscita), étaient conçues comme tant d’autres établissements pour recueillir les malades et pèlerins atteints de la lèpre, ce terrible fléau ramené d'Orient.
La pluie redoublait de violence, et Antoine Tête remonta sa capuche sur son visage déformé par la maladie.
Il arrivait tout en bas du chemin.
Aucune lumière, à part celle diffusée faiblement par la lune au travers des épais nuages, ne guidait ses pas.
Soudain il l’aperçut.
On le lui avait décrit comme l'avant-dernière étape de sa quête.
Il était là, masse sombre, constitué de simples pierres jointes enjambant le ruisseau Dolon : le pont du Petit Bon Dieu !
Maintenant il savait.
Il savait que ces innombrables nuits à marcher seul dans le froid n’étaient déjà plus que de sombres souvenirs.
A quelques pas se trouvait l’hôpital de Dolon, lieu de cure miraculeuse.
Machinalement il enfouit sa main gantée sous la robe de bure afin de s'assurer que sa bourse, contenant les trente florins nécessaires à son entrée dans la maladrerie, était toujours présente.
Il s’arrêta au milieu du pont pour mieux entendre, sous ses pieds, le rugissement de l’eau tumultueuse du Dolon à cette époque de l’année.
Face à lui, il devinait le petit chemin boisé des "Terreaux" qui le mènerait bientôt à la maladrerie salvatrice.
Le pont du Petit Bon Dieu… quel drôle de nom !
Passage ultime entre son passé heureux et son futur incertain.
Un simple pont en pierres que d’autres malheureux avaient dû franchir avant lui. Un simple pont... mais quel symbole !
L’ayant traversé, il se retourna une dernière fois. Son esprit fatigué ne put s’empêcher de vagabonder.
Plus tard… bien plus tard… si l’humanité survit à cette maudite lèpre, les générations futures prendront-elles soin de ce petit pont ?
Il remonta sur son front la capuche de toile grossière et s’enfonça lentement dans la nuit des temps…
Pour écouter la page en version audio veuillez cliquer ci-dessous