Les revoyres, le verger ou revoyre de Guigues GUIFFREY.
Il s’agit du hameau situé en haut du village après le cimetière.
Les mots de la famille rive, rivière, auxquels se rattachent les rivoires ont deux explications :
- Rivière, cours d’eau
- Rive, bord de la rivière, bord de toute espèce de choses.
C’est au sens de bord que peut se rattacher le nom des rivoires, surtout si l’on sait qu’il n’y a pas le moindre ruisseau sur cette petite bordure de coteaux.
Les mentions anciennes le verger ou la revoyre sont des pistes à ne pas négliger dans la recherche de l’explication de ce nom.
La Poyat :
Ce lieu-dit, où vous vous trouvez, se situe sur le chemin qui monte au cimetière. Ce nom vient du latin « podium » qui signifie lieu élevé.
Chantaillou :
Ce lieu, situé à proximité du cimetière actuel, était dans le passé propice aux rassemblements d’alouettes. Il signifierait donc « chantent alouettes ». A noter que le voisinage de ce lieu avec le cimetière a fait naître une expression locale qui a rapport avec la mort : « aller à Chantaillou » signifiant mourir.

Pour écouter la page en version audio veuillez cliquer ci-dessous
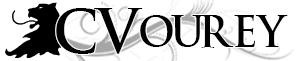
Depuis le moyen âge, ainsi qu’il était d’usage, le cimetière de Vourey se trouvait autour de l’église.
Planté de tilleuls et de buis, il fut longtemps, le lieu habituel des assemblées de la communauté villageoise.
Sa capacité permit, sans difficulté, de répondre aux besoins d’une population encore peu nombreuses jusqu’à la seconde partie du XVIIème siècle.
Déjà lors des premières assemblées de l’administration révolutionnaire, la question de son agrandissement s’était posée étant donné que la population commençait à croître fortement.
Le 24 avril 1791, le procureur de la commune, Monsieur Jean Jourdan, faisait remarquer au conseil : « Que chaque fois que l’on creuse une fosse, on est obligé de faire si près des autres, que l’on en sort très souvent des ossements qui ne sont point encore séparés les uns des autres. Que l’église étant trop petite, de même à cause de la population, on ne pourra se dispenser de la faire agrandir ce qui diminuera encore le cimetière d’autant. »
Le conseil décida alors l’acquisition d’un terrain à proximité de la cure, d’une surface de 241 toises.
Cette solution régla le problème pendant quelques décennies.
En 1834, la question ressurgit et on dut la résoudre par l’alternative suivante :
- Agrandir une nouvelle fois le cimetière.
- Trouver un terrain pour en aménager un nouveau.
C’est cette seconde solution qui fut retenue grâce à l’intervention de Louis Achille comte de Meffray, marquis de Cézarge.
Le comte de Meffray proposa, le 24 octobre 1791, un échange à la commune. Il consentait à céder un terrain pour établir un nouveau cimetière, à le faire entourer de murs et le fermer si la commune lui laissait la propriété à perpétuité de la chapelle de l’église. De plus, il acceptait de verser annuellement, au conseil une somme de 50 Francs.
La commune accepta sans hésiter et avec reconnaissance cette offre très avantageuse pour elle et l’échange fut réalisé officiellement le 29 novembre 1835.
C’est depuis cette époque que le cimetière de Vourey se trouve au sommet de la poyat, içi au lieu-dit chantaillou.
Les dates des tombes les plus anciennes de notre cimetière remontent d’ailleurs au 19ème siècle.
Son donateur, Monsieur Louis Achille de Meffray y repose dans l’ancienne partie en haut à gauche.
On peut y lire sur sa tombe :
"ICI REPOSE
Louis Achille comte de Meffray
Marquis de Sézarge
Décédé à Vourey le 21 janvier 1866
A l’âge de 84 ans
Vous qui passez, priez avec moi pour lui
Aimé de tous, il fut autour de lui
La providence pour les pauvres"
Louis Achille de Meffray était très ami avec Jean-Baptiste Félix de Bovier de Saint Julien, comte de Vourey à cette époque.
Ils servirent de modèle à Stendhal pour certains personnages de son livre « Lucien Leuwen ».
En ce qui concerne Jean- Batiste Félix de Bovier de Saint Julien il fut le modèle dans ce livre du marquis de Sanreal : « Gros, court, épais, incroyable de fatuité, et cent mille livres de rente ».
Quelques autres passages ne sont pas non plus à son avantage : « Et ce gros garçon, court et épais, qui me regarde de temps à autre d’un air supérieur et en soufflant dans ses joues comme un sanglier. Comment ! Vous ne le connaissez pas ? C’est le marquis de Sanreal, le gentilhomme le plus riche de la province. »
« Lucien n’avait d’autre consolation que d’examiner de près le Sanreal ; c’était à ses yeux le vrai type du grand propriétaire de province. Sanreal était un petit homme de trente-trois ans, avec des cheveux d’un noir sale, et d’une taille épaisse. Il affectait toutes sortes de choses, et par-dessus tout, la bonhomie et le sans-façon ; mais sans renoncer pour cela, tant s’en faut, à la finesse et à l’esprit. Ce mélange de prétentions opposées, mis en lumière par une fortune énorme pour la province et une assurance correspondante, en faisait un sot singulier. Il n’était pas précisement sans idées, mais vain et prétentieux au possible, à se faire jeter par la fenêtre, surtout quand il visait particulièrement à l’esprit. ».
Mais qui était Louis Achille de Meffray ?
Il inspira le portrait de Monsieur de Lanfort, dans le livre de Stendhal « Lucien Leuwen ».
Il était dans ce même ouvrage l’amant de la marquise de Puy-Laurens.
Sa description par Stendhal est plus flatteuse que celle de Jean-Baptiste Félix de Bovier.
« Sa personne était parfaitement agréable, son caractère doux, aimable et conciliant… Une fortune qui ne laisse rien à désirer. Il mesurait 5 pieds trois pouces (environ 1m70), avait des cheveux châtains et des yeux gris bleu ».
Stendhal dans ses notes sur ce livre écrit : « Le joli comte de Meffray ».
Sa générosité reconnue ici ne concerne pas seulement le terrain qu’il échangea pour l’établissement du nouveau cimetière, mais aussi d’autres actions en faveur de la commune et des pauvres.
En faveur de la commune, il convient de citer le traité qu’il passa avec Jules de Tourneuf pour concéder l’eau qui permit l’alimentation de la fontaine ronde. Il finança par ailleurs l’établissement du bassin et du triomphe de celle-ci ainsi qu’un lavoir à proximité sur le ri dolon, que l’on peut apercevoir sur certaines cartes postales anciennes.
Concernant les pauvres et alors que l’hiver 1847 avait été très rude, le curé de Vourey, dans une lettre adressée au journal « L’ami de la religion », écrivait : « L’honorable famille du comte de Meffray, propriétaire du château de Vourey, vient de mettre à ma disposition 2 500 kg de pain pour être distribués aux pauvres de Vourey, de telle manière que je puisse, jusqu’à la nouvelle récolte, leur en remettre 150 kg par semaine ; de plus, cette famille vient de prêter, sans intérêt, 3 000 francs à la commune pour faire venir du blé de Marseille, qu’on cédera au prix de revient aux habitants de Vourey ».
Sur les deux autres dalles-stèles du cimetère de Vourey, et à sa gauche, repose d’une part, une des sœurs Marthe Marie Joséphine décédée à Vourey le 17 août 1839 à l’âge de 59 ans, et, d’autre part, son mari Jean-Marie Constantin de Chaney, mort lui aussi à Vourey le 11 octobre 1839 à l’âge de 69 ans. Il existait peut-être autrefois les blasons des deux familles mais il ne reste aujourd’hui que celui de la famille de Chaney qui était « d’or à la bande d’azur chargée de deux étoiles d’argent accompagnée de deux casques de sable posés de profil ».
GALERIE PHOTOS








Pour écouter la page en version audio veuillez cliquer ci-dessous
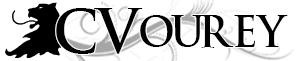
DU CIMETIERE DE VOUREY
La tombe de la famille Bonnardon :
La double concession enserrée de calcaire (sol de gravier) est dominée par deux stèles de taille voisine mais d'allure différente, adossées au mur nord du cimetière.
La stèle côté entrée repose sur une base peu élevée (bouchardée) au-dessus à trois pans, ce qui repousse à l'arrière le corps monolithe.
Celui-ci porte trois épitaphes (celle du milieu gravée dans une réserve rectangulaire à angles échancrés) et se termine en un plein cintre plus étroit du fait de la présence de rouleaux latéraux (terminés en moulures concentriques) posés sur les angles du corps.
Une autre réserve rectangulaire à angles (supérieurs) échancrés occupe l'arrondi et arbore en bas-relief une croix sur piédestal très raffinée : pied galbé, gorge soulignant le pourtour, bras terminés en boutons de pavots.
La stèle placée à l'est, beaucoup plus épaisse, est surélevée par une base haute (chanfreinée, bouchardée) qu'une série de moulures sépare du corps trapézoïdal (inscription). Des saillies de pierre sont ménagées en partie haute sur les côtés (supports pour couronnes mortuaires).
Une grosse moulure ronde (accompagnée de plus petites) enserre la partie haute sous une table saillante nue de faible hauteur. Le couronnement, fort saillant et épais, superpose moulures et sorte de linteau terminé par deux rampants faiblement inclinés convergeant vers un arc brisé central plus haut sculpté d'une croix.
Celle-ci paraît détachée du fond et traverse tout le couronnement. Sa surface à deux pans présente des terminaisons diverses (croupe au sommet du montant et pointe à sa base, traverse aux extrémités épatées) et des rinceaux (fort relief, fleurettes, feuillages, pommes de pin) s'échappent de part et d'autre.
La stèle occidentale est sans doute la plus ancienne. Son principe (avec croix sur piédestal, épitaphe toute largeur et retour à la ligne à la fin de la surface plutôt que pour des raisons de disposition esthétique) correspond bien à des pratiques courantes des années 1830-50 mais avec un traitement ici particulièrement soigné.

Adossée au mur nord, la double concession est revêtue de granit mais marquée par une stèle calcaire centrée qui n'occupe qu'une moitié de la largeur totale.
Posé sur le granit, le corps monolithe trapézoïdal présente des arêtes antérieures partiellement chanfreinées et comporte en partie haute des épaulements latéraux qui l'élargissent puis le rétrécissent.
Une large table saillante en forme d'écu (chanfreiné, partie basse en accolade) porte les inscriptions tandis qu'au-dessus, la partie élargie puis rétrécie est sculptée de motifs en bas-relief : une palme plate posée de biais sous une guirlande de baies d'ifs enrubannée (extrémités du ruban en fanions) suspendue à deux gros clous ronds ornés d'une fleur.
Des lettres en relief à la graphie travaillée annoncent entre table et sculptures la dédicace : "FAMILLE A[TIN en exposant] DECHAUX".
Le couronnement, indépendant, est constitué d'un élément en cœur renversé formant un enroulement autour d'une palmette et dont la pointe est remplacée par une croix (larges bras plats en pointe de flèche, fleurette dans un cercle au à la croisée).
Ce type de stèle terminée par une palmette arrondie ou une coquille est assez courant en pays Voironnais, comme le confirme l'exemple voisin mais plus sommaire de la tombe Soulier.
Quant à la table en blason (ou en écu), elle est aussi présente sur la sépulture Meurs.
On notera que la réfection du sol s'est faite en replaçant la stèle d'origine.

------------------------------------
Antoine Piraud
Curé de Vourey de 1885 à 1917
Né le 10 octobre 1850
Décédé à Vourey le 09 février 1917
------------------------------------
Madame Marie Piraud
Sœur du prêtre Antoine Piraud
Né le 25 décembre 1846
Décédée à Vourey le 05 avril 1912
------------------------------------
Adossée au mur sud, la double concession est délimitée par une bordure en calcaire sur laquelle sont fichés cinq balustres métalliques représentant des flambeaux (gaine carrée, cannelures, pointes, lierre, flammes se tordant) soutenant une chaîne (maillons rectangulaires à pointes, accroche au mur).
La stèle occupe pratiquement toute la largeur, posée sur un socle bas au moyen d'une base haute chanfreinée marquant des ressauts aux extrémités.
Sur ces avancées se dressent des montants latéraux, en saillie autour de la large table en retrait. Sous la mention "ICI REPOSENT" (dans une surface lisse dessinant un rectangle terminé par deux lobes qui sont presque des cercles), deux colonnes portent les épitaphes, chacune surmontée d'une réserve chantournée (quatre lobes, pointe centrale vers le bas) et moulurée.
Celle de gauche porte en bas-relief un livre ouvert autour duquel est glissé (comme un marque-page) un chapelet dont la croix pend dans la pointe.
Celle de droite offre de même un calice (pied rond, tige bulbeuse, coupe galbée plus haute que le pied) d'où émerge une hostie, tandis qu'une branche d'olivier à deux rameaux passe derrière.
La mention "DE PROFUNDIS" fait pendant à la première sous le trait de séparation des tables, des bandes bouchardées isolant ces inscriptions de la partie centrale.
Le couronnement monolithe dessine un cintre à ressauts, encadré d'acrotères et surmonté d'une croix (bras bourgeonnants). Un listel souligne le dessin général de l'ensemble tandis que le fond bouchardé est orné du mot "CHARITAS" en relief, surmonté d'un bouquet sculpté composé de trois pensées nouées d'un ruban (plissé et s'enroulant sur lui-même).
L'ensemble est signé du marbrier "LEVET à GRENOBLE".
Il s'agit de toute évidence d'un frère et de sa pieuse sœur (qui lui a servie de gouvernante dans son sacerdoce).
Les motifs sculptés sont explicites, celui du prêtre est courant mais le jumelage et celui de la sœur sont originaux, de même que le remplacement de la dédicace familiale par le nom d'une des trois vertus théologales : la charité (que complètent la foi et l'espérance, non mentionnées ici).
On notera la forme très traditionnelle, malgré les dates de décès qui auraient pu justifier un tout petit accent d'art nouveau.
La pensée dont le nom matérialise le souvenir est d'emploi très courant, dans ce cimetière voir par exemple les tombes Raphaël, Robert, Toquard, Monier Bernard, Caillat, etc..

Le tombeau de la Famille PIRAUD

Le prêtre Antoine PIRAUD
et sa soeur (en 1901)

Avis de décès du prêtre Antoine PIRAUD
Les tombes de la famille de Meffray
Très large (équivalente à quatre concessions), les tombes occupent l'extrémité du mur nord (angle Est) de l’ancien cimetière, et se trouvent partiellement bordées d'un petit muret de ciment postérieur aux trois dalles-stèles posées sur la terre.

La tombe dans l'angle en haut est monolithe (bloc de pierre massif). Sa base bouchardée rectangulaire est en partie enfouie et en partie déchaussée.
La dalle au-dessus de la base, est un peu bombée, et est sculptée en tête d'une croix en bas-relief suivie de l'inscription :
ICI REPOSE
Louis Achille comte de MEFFRAY
Marquis de Sézarge
Décédé à Vourey le 21 janvier 1866
A l'âge de 84 ans
Vous qui passez, priez avec moi pour lui
Aimé de tous, il fut autour de lui
La providence pour les pauvres.
Concernant la fin de cette épitaphe, le curé de Vourey, dans une lettre adressée au journal l’ami de la religion en 1847 (page 559) , écrivait : « L’honorable famille du comte de Meffray, propriétaire du château de Vourey, vient de mettre à ma disposition 2 500 kg de pain pour être distribués aux pauvres de Vourey, de telle manière que je puisse, jusqu’à la nouvelle récolte, leur en remettre 150 kg par semaine ; de plus, cette famille vient de prêter, sans intérêt, 3 000 francs à la commune pour faire venir du blé de Marseille, qu’on cédera au prix de revient aux habitants de Vourey ».
Les deux autres dalles-stèles (même taille) sont pratiquement identiques : haute base chanfreinée, dalle indépendante très épaisse, rectangulaire et plate, motif de croix incisé en tête suivi de l'inscription, trous carrés par paires aux quatre angles sur le dessus.
Outre les différences d'épitaphes, la garniture aux pieds diverge.
La dalle-stèle de la tombe centrale (Tombe de Marthe Marie Joséphine de Meffray – Sœur de Louis-Achille de Meffray) comporte à cet endroit une cavité assez profonde à fond plat, en rectangle avec deux lobes à la place d'un des longs pans.
La cavité de la dalle-stèle centrale évoque un double blason (à gauche (Blason famille Meffray) / à droite (Blason Césarges)) qui aurait été retiré ou non réalisé.
La dalle-stèle de la tombe du bas tombe de (Constantin de Chaney – beau-frère de Louis-Achille de Meffray) présente quant à elle un blason en relief très finement sculpté avec un fond piqueté, une bande transversale (montant vers la gauche) frappée de deux étoiles à cinq branches et les quartiers restants garnis de heaumes fermés (profil gauche).

La devise de cette famille était : Constant in fide (Ils sont fermes dans la foi)
La famille Meffray (ou Meffrey) de Césarges (on notera la différence d'orthographe avec l'épitaphe) portait un blason en deux parties, à gauche "de gueules au griffon volant d'or" (pour Meffray) et à droite "de gueules à la fasce d'or chargée de trois sautoirs de sable" (pour Césarges), avec pour devise "Timere vel mutare sperno" (Je n'ose ni craindre ni changer).

Blason de la Famille MEFFRAY

Blason de la Famille CESARGES
Commentaire historique :
La famille de Meffray fut propriétaire du château à Vourey (aujourd'hui Val Marie) en 1832, château à côté de l’église.
Le personnage inhumé est Louis-Achille comte de Meffray marquis de Césarges (fils d'un conseiller au Parlement, député de l'Isère de 1824 à 1830, gentilhomme de la chambre de Charles X, chevalier de la légion d'honneur et de Saint-Jean-de-Jérusalem) né en 1782 et qui eut de Mlle de la Tour-en-Voivre (woëvre) deux fils (Henry-Charles et Charles) dont l'un avec descendance – Henri-Charles).
C'est une de ses sœurs (Marthe Marie Joséphine de Meffray, décédée le 17 août 1839) et son beau-frère (Constantin de Chaney, décédé le 11 octobre 1839) qui reposent à côté de lui dans les deux tombes en dessous de la sienne.
C’est grâce à Louis-Achille de Meffray, suite à un don de l’un de ses terrains, permettant ainsi l’implantation du cimetière en 1835. Ce don était assorti pour la commune de Vourey de laisser la propriété à perpétuité de la chapelle de l’église ainsi que la concession funéraire à perpétuité de sa tombe ainsi que de celles de sa famille.
Tombe Yvonne Toquard :
-------------------------
Née le 1er Juin 1901
Décédée le 19 Juin 1904
Regrettée de sa famille.
Priez pour elle.
-------------------------
Installée au bord de l'allée centrale près du portail, cette tombe d'enfant se distingue par la présence d'une toiture abritant la concession.
Quatre cornières métalliques verticales, fixées (deux dedans, deux dehors) contre l'étroite bordure qui délimite l'emplacement (caisson de calcaire et de briques posé sur la bordure de ciment au contact de l'allée), sont reliées par des fers plats boulonnés : un posé en biais sur chaque long pan (avec des crochets intérieurs porte-couronnes) et deux courbés en quart de cercle formant arbalétriers autour de chaque cornière.
Le petit toit de zinc repose sur une grosse moulure métallique (boulons) ornée d'un lambrequin de tôle découpée (succession de festons en écu percé).
Le même motif mais dressé et non pendant, orne les arêtes du toit, complété à l'avant d'un antéfixe de tôle à trois lobes recourbés pour évoquer de grands pétales. Sur la faîtière, une petite croix tubulaire (pied rond mouluré, bras épointés) métallique marque l'extrémité avant, tandis qu'une mince plaque découpée garnit le restant en dessinant deux vagues affrontées autour d'un médaillon ovale.
Sous cet abri, le caisson rétrécit la surface et la rehausse car il est rempli aux trois-quarts.
Une grille métallique juxtaposant les S affrontés par paires (une croix) est placée à l'intérieur du caisson, en ménageant un petit espace libre à l'arrière.
C'est là, hors de la grille mais au bord du caisson et sous le toit, que se dresse la petite stèle, en recul sur son socle bas.
La base moulurée porte un corps trapézoïdal à découpes latérales inférieures et supérieures (celles-ci en acrotères).
L'épitaphe occupe presque toute la surface, à l'exception de la pointe constituée par les deux rampants du haut culminant en une croix.
Une réserve ovale y présente en effet une pensée sculptée.
L’ampleur donnée à la tombe de cette fillette de trois ans, que n'a rejoint aucun des siens, est rare.
L'utilisation d'un toit, qui plus est largement décoré, n'est pas plus courante dans les sépultures voironnaises et iséroises.


Groupés derrière une croix en pierre, quatre monuments sont entassés dans un espace restreint qui ne laisse d'évidence pas de place pour des concessions, sur un sol plus haut par degrés vers l'est.
Tous comportent une stèle rectangulaire épaisse et peu élevée sur le dessus de laquelle sont sculptés des objets caractéristiques des ecclésiastiques.
A l'ouest, la première quasi collée à la croix superpose socle mince (quasi enfoncé dans le sol), base haute (saillante, chanfreinée) et corps (bouchardé, table lisse à coins échancrés avec inscription vers l'est). Le chaperon (saillant, mouluré, dessus plat) porte une petite croix dressée (centrée, au fond, incision interne) devant laquelle figurent une petite étole (à plat, extrémités frangées retombantes) et une barrette pliée (très plate). L'ensemble est très raide et un piédestal de croix métallique est déposé contre.
Le monument central, aligné sur la croix mais à distance, est bien plus riche.
Sur le socle (chanfreiné, affleurant), la base (moulurée, plaque de marbre rapportée à coins échancrés avec épitaphes) soutient le corps droit massif abondamment sculpté : couronne de lys et de boutons de pavots au-dessus d'une inscription dans un cadre incisé au nord, réserve moulurée avec épitaphe à l'ouest, coussin galonné en haut-relief sur le dessus dont les quatre pompons retombent sur les côtés.
L'étole (chenillée, galonnée de bâtons rompus, frangée) posée de façon naturelle (plis) sur le dessus laisse retomber les glands de ses cordonnets sur la face ouest et les pans (marqués d'une croix de Malte rayée à bouton central et cordonnet au pourtour) sur la face sud, au-dessus d'une inscription (cadre incisé).
Un bonnet conique à gros pompon repose sur l'étole, maintenu par une croix.
Dans le même alignement, le monument Est reprend le même modèle que le précédent mais dans une taille un peu supérieure et en position inverse (face principale à l'est).
Les pans de l'étole et l'inscription se trouvent donc au nord, la couronne végétale (beaucoup moins fouillée).
Il n'y a pas de plaque rapportée sur la base.
Le dernier monument occupe le côté sud le long des deux précédents et comporte une partie au sol sous la forme d'une dalle (socle ciment, base chanfreinée) traitée en couvercle de sarcophage. Etroite et basse, à quatre pans (mention "PRIEZ POUR LUI" gravée à l'avant), elle est totalement traversée par une croix (traverse pleine coupant les pans latéraux).
A la tête de cette dalle, une stèle posée sur l'extrémité de sa base et assez voisine de la première (moins épaisse et moins haute que celles à coussin) porte sur son corps droit une épitaphe à l'ouest.
Une modeste tablette saillante sur trois côtés la termine, garnie d'un calice posé au centre (pied à double bague, coupe en tulipe, petites hosties posées dessus) sur lequel s'appuie un livre fermé (reliure travaillée).
L'étole assez raide enveloppe le calice de ses deux pans qui retombent à l'avant (franges, galon) et conditionnent l'emplacement de l'épitaphe.
Une barrette pliée est posée sur l'étole côté nord. Il est possible que les monuments aient été rassemblés pour dégager le passage ou qu'ils aient été privés par l'enrobé du terrain utilisé pour les différentes sépultures.
Les traces sur le monument complétant la dalle en sarcophage montrent que les deux étaient jointifs au départ.
On notera que l'un des prêtres n'a pas été desservant de Vourey et qu'un autre a été rejoint par sa famille, ce qui est exceptionnel car les sépultures familiales ne sont pas mises en exergue près de la croix.
Les éléments représentés sont aussi à comparer à ceux de cet autre prêtre.
De 1828 au 19 novembre 1846 : Pierre THOMAS-JAVID, né à La Frette (Isère) le 3 frimaire an 12, fils de Claude et de Marianne Bergeret, décédé à Vourey le 19 novembre 1846. Au cimetière, dans les monuments consacrés aux prêtres, on peut lire : « A la mémoire de Pierre THOMAS-JAVID, curé de Vourey, décédé le 19 novembre 1846, âgé de 45 ans un de profundis. La paroisse reconnaissante ». Sur une face du monument est écrit : « Seigneur, donnez-lui la récompense du juste » et sur une autre face : « Pasteur zélé et prudent, il sut faire aimer et pratiquer la vertu ». On trouve encore : « Il fut la providence du pauvre, la consolation de l'affligé, mort si jeune, son souvenir vivra à jamais dans le cœur de ses chers paroissiens ».
De 1846 à 1879 : Pierre GRAND, fils de Claude François et d’Anne Pélissier, né à Corps (Isère) le 23 novembre 1807, décédé à Vourey le 19 février 1879. Sur une pierre tombale du cimetière on peut lire : « Homme de bons conseils, rempli de douceur et de droiture, il conduisit ses ouailles vers Dieu en inspirant à tous l'amour de la Paix et de la Bonté ».
De 1879 à 1885 : Joseph BECT, né à Commelle (Isère) le 30 avril 1823, mort à Vourey le 8 juillet 1885, fils de Jean-Baptiste et de Marie-Anne Plantier.
Sur le monument consacré aux prêtres, on peut lire : « A la mémoire de Mr l’abbé Joseph BECT, né en 1823, curé de Vourey de 1879 à 1885. Souvenir reconnaissant ».
De 1917 à 1931 : Jean TRUCHET, né vers 1854, démissionnaire. Sur le monument des prêtres on peut lire : « A la mémoire de Mr l’abbé Jean TRUCHET, curé de Vourey 1917-1931, sa paroisse reconnaissante. Requiescat in pace ».
